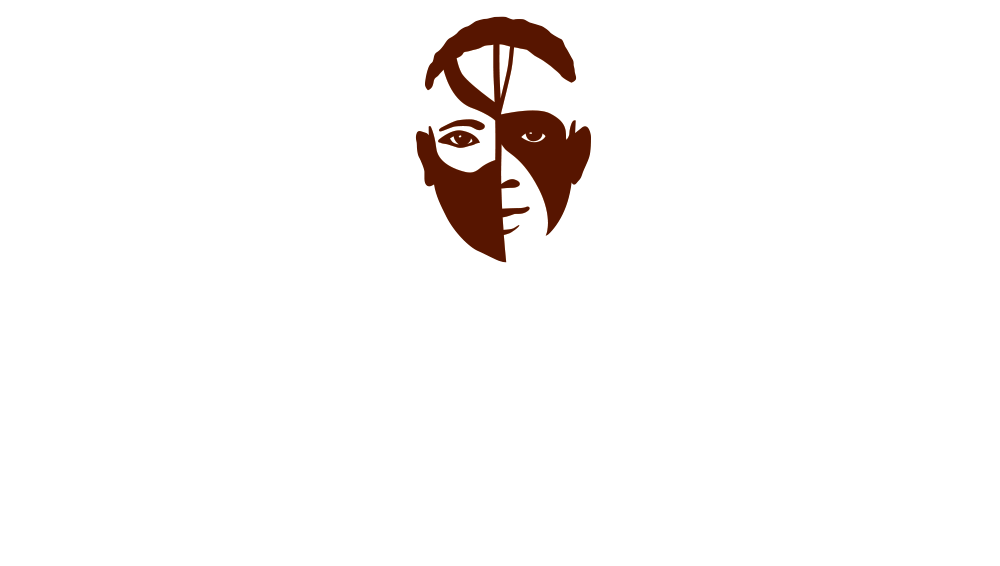Pratiques et représentations religieuses kanak
ALBAN BENSA et CLAUDE GRIN
L’expression religieuse kanak originelle est en voie de disparition. Alors que, jusque dans les années 1990 environ, le christianisme, catholique ou protestant, sur la Grande Terre, semblait coexister avec un vigoureux culte des ancêtres, depuis deux décennies, se mettent en place progressivement des syncrétismes. Ce basculement réduit l’importance du travail de communication avec les ancêtres et autres esprits, tandis que se développent des rites et des discours qui empruntent aux religions et sectes chrétiennes. Ces métamorphoses du religieux kanak contemporain, et le peu d’études dont il fait l’objet, rendent urgentes de nouvelles enquêtes de terrain et publications.
Les transformations économiques dues au développement du nickel dans la Province Nord, où réside la majorité des Kanak, favorisent l’abandon de l’agriculture, l’urbanisation et, par-là, une érosion des savoirs traditionnels dans tous les domaines. Les relations étroites entre les pratiques religieuses, la connaissance des plantes et la transmission des mythes rendent ainsi d’autant plus urgentes des enquêtes permettant de garder mémoire de pans entiers de connaissances kanak, qui s’altèrent aussi en raison du recul de l’usage des langues vernaculaires.
En s’appuyant sur une solide connaissance de la Nouvelle-Calédonie kanak et forts d’une insertion dans les communautés du centre-nord de la Grande Terre, nous proposons ici des matériaux et des enquêtes de première main à propos des rapports qu’entretiennent les Kanak avec les forces ancestrales invisibles, mais signalées par des plantes, des minéraux et aussi des objets spécialement manufacturés (monnaies de coquillages, sculptures, paquets d’écorce propitiatoires, planches à rêves).
Cette ethnographie prendra d’abord un tour ethnolinguistique : recueil et analyse du vocabulaire religieux à partir d’une connaissance précise de la langue paicî et, surtout, à travers notre propre implication dans des rituels appelant l’intervention des ancêtres. La réfraction de ces expériences dans la problématique chrétienne contemporaine sera étudiée à partir de récits de vie livrés par des personnes riches d’expériences spécifiques (thérapeutes, voyants, prêtres et pasteurs kanak).
Nous observerons en particulier les modifications dans l’appréhension de la temporalité kanak ancienne, induites par le passage à l’économie urbaine et par le poids des conceptions chrétiennes messianiques du temps. Les Kanak passent en effet progressivement d’une représentation spatialisée et immanente du temps (présence des ancêtres sur les sites sacrés) à une conception non territoriale de la temporalité, qui insiste sur la transcendance du divin et son déploiement dans le temps long de l’accomplissement des prophéties des Écritures.
Cette transformation profonde et intime de l’expérience religieuse kanak n’a pas été revisitée depuis les travaux pionniers du pasteur ethnologue Maurice Leenhardt (1878-1954).
Sera donc développé un volet de recherche concernant les techniques thérapeutiques des guérisseurs kanak. La question des relations aux ancêtres sera aussi abordée à partir de la pratique du rêve et d’autres modifications des états de conscience ouvrant vers l’autre monde. Cette enquête empirique auprès de personnes encore porteuses de ces représentations sera appuyée par un travail historiographique sur les textes traitant, depuis deux siècles, de la pratique religieuse kanak, ainsi que de l’influence des églises.
En associant une connaissance approfondie du monde kanak acquise durant plusieurs décennies (Alban Bensa) aux acquis de recherches de longue haleine sur les relations aux morts construites et entretenues par les médiums thérapeutes urbains (Claude Grin), nous pensons être en mesure, après une pré-enquête réalisée en 2015, de mener une recherche approfondie, au plus près des populations.
Une insertion de longue date dans le tissu social local, tant auprès des femmes que des hommes, nous permet d’être immédiatement au cœur du sujet, c’est-à-dire de situations impliquant le recours aux ancêtres ou à toutes autres entités importées. En outre, la compréhension de la langue paicî par l’un d’entre nous facilite à l’évidence l’entrée dans la réflexion théologique kanak, animiste ou chrétienne. La participation à l’enquête d’une anthropologue (Claude Grin) nous donnera en outre accès aux pratiques traditionnelles féminines.
Ce travail prendra aussi appui sur un corpus de textes kanak, oraux ou écrits, pour la plupart inédits. Ces documents seront travaillés avec des érudits kanak de villages, dans le cadre de la présente enquête, et feront l’objet d’une restitution progressive aux populations concernées des documents établis par nos soins, en compagnie de leurs parents et grands-parents.
Enfin, l’entreprise de recherche que nous proposons aboutira à la rédaction d’un ouvrage qui réévaluera les travaux sur la question, et présentera les pratiques, les croyances, les objets et autres œuvres en rapport avec l’ancestralité et ses métamorphoses, tels qu’ils peuvent apparaître aujourd’hui à des ethnographes chevronnés.
Alban Bensa et Claude Grin
Paris, Lausanne, 14 janvier 2016